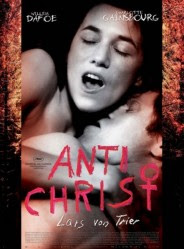Laureat 2009 du PRIX HEMINGWAY
Me llamo Jaime Pérez Pérez, tengo dos
cabras y un hermano guardia civil.
De la tradition orale
Premier pastis
Il y a, dans le voisinage des arènes du Puerto de Santa María, un café qui s’appelle « Aqui Te Espero ». Le bar au comptoir duquel le frère de Pérez se tenait ne s’appelait pas comme ça, dommage. Le bar au comptoir duquel le frère de Pérez se tenait s’appelait autrement, mais il se trouvait aussi à proximité des arènes. Pas celles du Puerto, celles d’un autre endroit. C’était déjà ça. Là, il venait juste d’articuler une phrase qu’il avait peut-être déjà prononcée des milliers de fois :
- Enfin, c’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Bon, je vais pisser un coup.
Si la patience est une vertu, le frère de Pérez aurait pu légitimement prétendre au rang de la sainteté. Mettons là, il allait pisser. Après, il se laverait les mains, même avec du savon liquide, s’il y en restait dans le distributeur, il n’était pas le dernier pour l’hygiène non plus. Bon, comme presque tout le monde, mais lui, il serait capable d’attendre sous le sèche-mains électrique que l’air chaud eût avalé jusqu’au dernier atome d’humidité sur le bout de ses doigts. Ce qui, on le reconnaîtra, est humainement à peu près impossible. Beaucoup trop long. N’importe qui de normalement constitué, vous et moi, on finit toujours de s’essuyer sur les jambes du pantalon ou sur les basques de la veste. Mais le frère de Pérez, lui, il avait une patience à l’épreuve des bombes.
Il avait aussi, qui est une qualité presque corollaire à la première, de la suite dans les idées. Ce n’était pas une petite miction vite fait qui allait lui faire perdre le fil.
- Comme je disais, c’est pas grave, ça se représentera. Des fois, ça peut se présenter quand tu t’y attends même pas.
Le bar au comptoir duquel le frère de Pérez attendait, chaque jour de sa vie, ne s’appelait pas « Aqui Te Espero ». Il s’appelait autrement, dommage pour la littérature. Il s’appelait, disons, le « Café des Arènes », ce qui, bien regardé, n’est pas une mauvaise raison sociale non plus.
- En plus, ça tombe trop pas mal, j’ai plein d’autres trucs en train. Pas plus tard qu’hier, on m’a proposé de faire le taureau pour un jeune qui commence. Tous les matins, sauf le dimanche, presque un poste fixe. J’ai pas dit oui, mais j’ai pas dit non. Et comme j’ai pas dit non, c’est comme si j’avais dit oui, non ?
Le frère de Pérez avait une assez bonne réputation de taureau. Et puis, on savait presque toujours où le trouver. C’était commode. Si on avait besoin d’un taureau pour l’entraînement, comme ça, au pied levé, on allait au Café des Arènes.
- Dis, tu nous ferais pas le taureau une paire d’heures, on a une roue du carretón qui s’est pétée.
S’il n’avait pas mieux à faire, le frère de Pérez ne disait pas non. Il avait rarement mieux à faire.
- Moi, ce que les gens apprécient, c’est que je fais le taureau nature. Pas besoin de la charrette ni rien. T’as déjà vu un taureau pousser une brouette dans une corrida ? Bon. Alors moi, c’est pareil, je fais le taureau nature, sauf que moi, après je peux aller boire un coup avec le torero.
Le frère de Pérez ne se faisait pas payer pour faire le taureau, mais si on lui offrait le verre de l’amitié après, il ne disait pas non. Il disait rarement non à quoi que ce soit. Il y avait une chose, en revanche, qu’il répétait souvent :
- C’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Remets-moi ça, Jacky.
- Ça marche.
Deuxième pastis
Les gens n’étaient pas unanimes sur les aptitudes physiques et mentales du frère de Pérez. Personne ne contestait sa disponibilité, bien sûr, ni sa bonne volonté, encore moins sa presque angélique patience (qui l’aurait osé ?), mais, pour le reste, les avis était partagés. Certains discutaient parfois, jamais en sa présence, la rectitude de sa charge et l’équilibre de sa raison.
- Réfléchis une chose, faire le taureau nature, ça t’entraîne vachement pour toréer à la naturelle. C’est pour ça que je dis jamais non quand on me demande. L’important, c’est de rester dans l’ambiance et de bien se préparer pour quand ça arrivera. Parce que ça peut arriver n’importe quand, même pendant que tu es en train de faire le taureau pour un jeune qui commence. Réfléchis, toi tu t’y attends pas, tu es en train de faire le taureau pour un jeune qui commence et tu as un directeur d’arène qui passe par là, ou un apoderado un peu fort, ou le président d’un gros club taurin. Il te voit et il se dit : un type qui fait le taureau comme ça, ça doit être un morceau de torero. Et il te fait entrer dans une feria. Après, c’est à toi de faire ce qu’il faut devant le taureau, de montrer que tu es là. C’est pour ça qu’il faut être préparé pour quand ça arrivera.
Il paraît que le grand Joselito a dit un jour : « Celui qui n’a pas vu une corrida au Puerto de Santa María ne sait pas ce qu’est un après-midi de taureaux ». C’était le contraire pour les arènes proches du bar au comptoir duquel le frère de Pérez se tenait : on pouvait se faire une idée tout à fait précise de ce qu’est un après-midi de taureaux sans y avoir jamais mis les pieds. Mais si on était curieux de cette étrangeté qu’on appelle parfois tauromachie de salon, on pouvait trouver moyen d’y apprendre deux ou trois bricoles, chaque matin (sauf le dimanche). Par exemple comment faire le taureau au naturel, sans aucun artifice, sans carretón, sans même une paire de cornes factices, rien, juste avec les bras écartés et le corps plié en avant. Juste ça et un survêtement gris à parements lilas.
- Ce que je dis, c’est que c’est l’afición qui compte. Si tu as l’afición, y a pas de honte à faire le taureau. Au contraire. Si tu réfléchis, combien tu en as, des matadors de première qui on commencé en faisant le taureau ? Fais le compte. Sûrement un bon paquet, non ? Faut bien commencer par un bout.
Pour la question du verbe avoir, le frère de Pérez avait chez lui une femme légitime et une petite flopée de gosses à qui il portait un intérêt plutôt lointain, il avait un téléphone portable qui sonnait l’air du paso-doble Suspiros de España, une Peugeot 504 break, une vieille muleta de fabrication maison et une cape. La cape n’était pas toute neuve non plus, mais elle avait appartenu à un torero qui avait même défilé un jour dans les arènes du Puerto de Santa María. Ce qui donnait au frère de Pérez un motif supplémentaire de ne pas désespérer. Tout pouvait arriver, il suffisait d’attendre, rester dans l’ambiance et se tenir préparé. Et tant qu’on ne lui avait pas démontré a plus b que tout ne pouvait pas arriver, le frère de Pérez ne voyait pas pourquoi il aurait eu à désespérer, malgré les ajournements perpétuels et les faux bonds en cascades.
- Là, on m’avait parlé pour une course, pas un gros gros truc, une capéa dans un bled, mais on sait jamais, si un apoderado un peu fort passe par là. Finalement, on vient de m’appeler, ça va pas se faire. Une histoire avec les vétérinaires qui font des embrouilles avec le bétail ou je sais pas quoi…
Ce que le frère de Pérez n’avait pas, c’était un emploi fixe. D’ailleurs, il n’avait pas le temps, ni l’esprit à prendre un emploi fixe. Un emploi fixe, ça risquait de le sortir de l’ambiance. Pour les contingences du quotidien, il y avait les prestations sociales. Et puis, il grattait par ci par là dans ce qui se présentait, jamais longtemps, un peu dans le bétépé, un peu dans l’agricole, et lâchait aussitôt qu’on lui proposait de faire le taureau pour un jeune qui commençait. Pour pas un rond, juste le verre de l’amitié. Ce que le frère de Pérez n’avait pas non plus, c’était un sens énorme de la tempérance. Et pas une once de bon sens.
- Enfin, c’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Remets-moi ça, Jacky.
- Ça marche.
Troisième pastis
Si on voulait contacter le frère de Pérez, on savait comment faire. Le plus simple, c’était d’aller le trouver au comptoir du bar qui, en littérature bien administrée, aurait dû s’appeler « Aqui Te Espero ». Mais s’il n’y était pas, s’il était pris ailleurs, à des affaires de tauromachie de salon dans les arènes voisines ou à se faire un peu de black sur un chantier quelconque, on pouvait le joindre sur son portable. Pas toujours, cependant. Quand il était occupé à faire le taureau, le frère de Pérez ne répondait pas, personne n’a jamais vu un taureau prendre un correspondant en ligne pendant une corrida, mais on pouvait laisser un message. Quand il rallumait son téléphone, il avait toujours un petit frisson. On ne savait jamais, si un apoderado un peu fort avait appelé pour lui proposer de le faire entrer dans une feria. Le portable, c’était le fil au bout duquel pendaient les chimères du frère de Pérez.
- Le problème, c’est que je fais pas les banderilles. Si je faisais les banderilles, peut-être je serais déjà en haut. Une fois, un directeur d’arène voulait me faire entrer dans sa feria. On lui avait parlé de moi. Il m’appelle, il me dit : si tu veux, je te fais entrer dans ma feria, pas un gros gros truc, une non piquée en matinale avec du bétail d’ici, mais on verra ce que tu vaux. Pas de problème, je dis. Après, il me dit : tu fais les banderilles ? Non, je dis, je fais pas les banderilles. Et je suis pas entré dans cette feria. Sûrement, je devrais faire les banderilles, ça leur plait, aux gens, quand on met les banderilles. Mais je sais pas, je le sens pas.
Le frère de Pérez, ça se comprend, ne voulait pas non plus entendre parler des banderilles quand il faisait le taureau. Ceux qui voulaient s’entraîner à la pose des harpons devaient s’arranger sans lui, se débrouiller avec la charrette équipée d’une planche d’aggloméré de sept à la place du garrot et un collègue pour la pousser. Le frère de Pérez, lui, jamais il ne poussait la charrette. Il faisait ça à l’ancienne, en payant cash de sa personne et sans roue de vélo. Il pensait que c’était un accessoire inutile, la charrette, une superfétatoire commodité. C’était d’ailleurs à peu près la même chose qu’il pensait des banderilles, un expédient pour obtenir des applaudissements à bon compte, une fioriture sans vraie valeur tauromachique, une vaine futilité.
- Ce qu’il faut pas oublier, c’est que c’est un combat. Tu te joues la vie, là-dedans. C’est pour ça, le taureau, faut que tu le respectes. Que tu le respectes et que tu t’en méfie. Sinon, il a vite fait de te renvoyer d’où tu viens. Et essaie pas de la lui faire en biais, parce qu’il les aura toujours plus grosses que toi, le taureau. Une fois, j’ai failli en toucher un, un vrai tío, celui-là, si je l’avais touché, bon, je l’aurais respecté, d’accord, mais si je l’avais touché, ils auraient vu. C’était juste le taureau comme il me faudrait pour que ça démarre. Après, ça a pas pu se faire, ils m’ont pas laisser entrer en piste, une merde avec le syndicat parce que j’avais pas la carte où je sais pas quoi.
Quand il parlait de tauromachie, et il traitait rarement d’un autre sujet, le frère de Pérez pouvait parfois rappeler ces mystiques qui, inspirés par le Paraclet, deviennent capables d’émettre à jet continu un galimatias à eux seuls compréhensible. Sauf que son Paraclet à lui dégageait une forte odeur d’anis.
- Enfin, c’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Remets-moi ça, Jacky.
- Ça roule.
(Jacky, le patron du Café des Arènes, s’amusait parfois à prendre la clientèle un peu à contrepied.)
Quatrième pastis
Si le frère de Pérez avait une assez bonne réputation de taureau, sa cote pour un certain nombre d’autres activités n’était pas mauvaise non plus. Selon les besoins, il pouvait aussi bien être requis comme colleur d’affiches de corridas économiques, tourneur de méchoui pour les fêtes de clubs taurins, porteur en triomphe éventuel dans les spectacles de seconde classe ou même adjoint à l’aide du valet d’épées d’un jeune qui commençait. Il ne s’en rendait pas compte, bien sûr, mais il agissait comme un cheval de Troie à l’envers. C’était ce qu’il disait toujours, l’important était de rester dans l’ambiance.
- C’est ce que je dis toujours, l’important, c’est de rester dans l’ambiance, de te montrer, de te faire connaître et d’être prêt pour quand ça arrivera.
Le frère de Pérez avait ça de commun avec, mettons comme exemples de persévérance, Bernard Palissy, Vincent Van Gogh ou Mohandas Gandhi, la patience, l’obstination, certains diraient l’entêtement, une certaine forme de résistance vaguement passive face à l’adversité. Et la croyance dure comme le fer de la jambière d’un picador que ça finirait par arriver.
- C’est obligé que ça arrive. Quand tu as l’afición, si tu as quelque chose entre les jambes et que tu respectes le taureau, ça peut pas faire autrement qu’arriver. Et toi, tout ce qui te reste à faire, c’est d’être là au bon moment. Et toujours prêt, toujours bien entraîné.
Pour l’entraînement, bien sûr, il avait quelques lacunes. Ce qu’il aurait été obligé de reconnaître, s’il avait été capable d’examiner les faits d’un œil moyennement objectif. Comme taureau, pas de discussion, il était plus et mieux entraîné que quiconque. Mais pour l’inverse, il avait comme un peu de retard. Oui, pour ce qui était de toréer un novillo, une vache ou même un veau, ça ne s’était pas présenté, jusqu’alors. Des centaines de fois il avait été sur le point. Et au dernier moment, il y avait quelque chose qui merdait à chaque coup. Il se trouvait toujours, sur la route du frère de Pérez, des vétérinaires, des syndicats ou Dieu sait quoi pour faire capoter le truc au dernier moment. Il s’en conformait, en se disant que ce serait pour une prochaine fois. Le frère de Pérez était comme un conquistador immobile, et longuement malchanceux, pour qui l’avenir était toujours derrière la montagne suivante.
Comme taureau, pas de problème, il ne manquait jamais d’amateurs pour se frotter à lui, contre le prix du verre de l’amitié ou non, le frère de Pérez n’obligeait personne, c’était à la discrétion, à la bonne volonté de chacun. Mais pour l’inverse, pour la réciproque, on veut dire, il n’y avait pas un, parmi les toreros aspirants qu’il fréquentait, pour accepter de charger dans sa muleta. Même pas avec le carretón (qui était, selon le frère de Pérez, le pauvre succédané des taureaux pusillanimes). Peut-être pensaient-ils qu’il y avait un risque de déchoir, à faire le taureau pour un type qui était quasiment devenu illustre, dans la spécialité. Ou alors ils avaient peur de lui, peur qu’à la fin d’une série, il leur plante pour de bon l’épée dans le dos. Le fait qu’il ne possédât pas d’épée était un détail très secondaire. Ils disaient entre eux, jamais en sa présence :
- Le frère de Pérez, il est beaucoup trop toréé pour faire un torero comme il faut. Il a pas d’art ni rien. Et puis, avec tout le pastis qu’il s’envoie, tu sais jamais comment il peut réagir. Aussi bien, au dernier moment, il te met une estocade avec une banderille ou le bâton de la muleta, tu vois.
Le frère de Pérez avait fini par s’en faire une raison. Comme torero, il s’arrangeait à s’entraîner tout seul, à embarquer des taureaux imaginaires dans des passes qu’il s’efforçait de faire durer en lenteur. Parfois, il y parvenait sans trop de rugosité. Alors, il se votait un olé pour lui seul, un olé, dirait-on, à usage interne. Il ne doutait pas que, quand le moment serait enfin venu de combattre un véritable adversaire, un vrai taureau en viande et en os, celui-ci chargerait avec autant de constance que la brise du soir ou le vent qu’il avait lui-même dans les voiles. Car, à vue d’œil, c’est vrai, le frère de Pérez pouvait contenir plus de pastis que n’importe qui d’autre au monde. Sans préjudice des autres alcools qu’on voulait bien lui payer. Et si on ne voulait ou ne pouvait pas, il n’en faisait pas une jaunisse. Il avait l’habitude, une habitude presque atroce, de se débrouiller tout seul.
- C’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Remets-moi ça, Jacky. Sur mon compte.
- Ça marche.
Cinquième et autres pastis
À mi-chemin entre les arènes du Puerto de Santa María et le café nommé « Aqui Te Espero », on ne sait quelle peña de thanatopracteurs a fait ériger une statue du défunt, tragiquement défunt matador Paquirri, mort par corne de taureau à Pozoblanco, en train de réaliser la passe dite larga afarolada de rodillas, selon toute vraisemblance a porta gayola, puisqu’il faut bien donner un nom à chaque chose, et avec toute la précision possible, aux débits de boissons comme aux passes de capes, aux types qui font le taureau au naturel comme, paraît-il, aux taureaux. Si on ne donne pas un nom à chaque chose, et avec toute la précision possible, on finit pas s’emmêler les pinceaux. Forcément.
Entre les arènes et le bar au comptoir duquel se tient le frère de Pérez, il n’y a de statue de personne. Il y a une petite esplanade, ça oui, un chétif alignement de platanes, peut-être un rectangle de poussière plus ou moins spontané pour jouer aux boules, mais aucun groupe sculptural. Il faut dire aussi que personne n’est jamais mort dans ces arènes (dans celles du Puerto de Santa María, on ne sait pas, on suppose que si), personne, en tout cas, par corne de taureau. Il y a bien eu, une fois, un vieux mort de crise cardiaque. Ça ne vaut pas une statue, même pour le plus vil des thanatopracteurs. Le frère de Pérez n’en est pas encore à espérer d’avoir, le moment venu, sa statue devant ces arènes, pas très loin du bar au comptoir duquel il se tient. Pour l’instant, il n’y pense pas. Il sait que la route sera longue, depuis le jogging taupe à garnitures parme jusqu’à l’habit de lumières céleste et or.
- Ça se fera pas demain, je le sais bien. Tout ce que je demande, c’est qu’on me donne ma chance. Après, à moi de faire mon chemin.
Quant à la statue, si parfois, confusément, il y pense, il n’est pas pressé d’y arriver. Quand tu as ta statue devant les arènes, c’est presque toujours mauvais tabac, c’est que tu as commencé à bouffer les pissenlits par la racine (avec quoi, si on les distille, on peut produire une liqueur qui n’est pas loin de rappeler l’absinthe, en plus fort), que les vers t’ont déjà mis la dent dessus. Non, le frère de Pérez n’est pas pressé d’arriver à ça. Il n’est pressé de rien, il attend. Il attend. Et, en attendant, il fait le taureau pour les autres, le torero pour lui seul, il fait l’apéro pour tromper l’attente et un chantier par-ci par-là, parce qu’il faut bien bouffer.
Le frère de Pérez n’est plus très jeune. Si on veut être franc, on dira qu’il a même passé de bien loin l’âge des grandes espérances. Raisonnablement parlant, ses chances de devenir jamais une vedette de la tauromachie sont infimes. Non moins infimes sont celles de trouver tous les bons numéros du loto. Ça ne l’empêche pas de jouer, quand il a trois ronds d’avance. Un jour ou l’autre, il faudra bien que ça tombe. D’un côté ou de l’autre. Le tout, c’est d’attendre et de se tenir prêt.
On n’est pas devin, mais il est une chose qu’on peut affirmer : à force d’attendre, le frère de Pérez finira par y rester. Ce qu’on ne sait pas avec toute certitude, quoiqu’on ait sa petite idée, c’est si ça sera d’un coup de corne ou d’un cancer du foie. Ce jour-là, au lendemain duquel, selon toute probabilité, aucun thanatopracteur ne proposera de faire tailler une statue en son honneur, on aura une suggestion à faire à Jacky, le patron du Café des Arènes. Ce jour-là, où le frère de Pérez aura fini d’attendre au comptoir, où il commencera à attendre dans la sépulture jusqu’à l’extinction des siècles, on proposera à Jacky, le patron du Café des Arènes, de rebaptiser son établissement « Aqui Te Espero », en mémoire du plus assidu, du plus stable de ses clients. On n’est pas sûr qu’il acceptera.
- C’est pas grave, ça sera pour une autre fois. Remets-nous ça, Jacky.
- Ça marche.
 Bon alors, comment on les place les bras ? On a répété pourtant, qu’est-ce qu’elle nous a dit déjà ? Comme ça ? Ouverts en delta et souriante parce qu’on a reconnu mémé dans la salle ? Ou toute pensive et déjà pleine de grâce d’une brassée certes pas assez courbe mais au moins symétrique, poignets fléchis, mains en pronation ? Mine contrite et bras en suspens peut-être, ni ouverts, ni serrés, ni en l’air, ni en bas - si on pouvait être ailleurs… - et quitter cette allure d’échassier désailé… Tiens ben moi, chui pas très concerné mais j’leur fais le V de la victoire si ça leur fait plaisir, mais pour le sourire ils repasseront, j’le sens pas là… Sont nulles ou quoi, les autres ? Moi je regarde le chorégraphe dans la coulisse et je vois bien qu’il faut éclairer le plateau de mes chandeliers brachiaux… n’importe quoi…
Bon alors, comment on les place les bras ? On a répété pourtant, qu’est-ce qu’elle nous a dit déjà ? Comme ça ? Ouverts en delta et souriante parce qu’on a reconnu mémé dans la salle ? Ou toute pensive et déjà pleine de grâce d’une brassée certes pas assez courbe mais au moins symétrique, poignets fléchis, mains en pronation ? Mine contrite et bras en suspens peut-être, ni ouverts, ni serrés, ni en l’air, ni en bas - si on pouvait être ailleurs… - et quitter cette allure d’échassier désailé… Tiens ben moi, chui pas très concerné mais j’leur fais le V de la victoire si ça leur fait plaisir, mais pour le sourire ils repasseront, j’le sens pas là… Sont nulles ou quoi, les autres ? Moi je regarde le chorégraphe dans la coulisse et je vois bien qu’il faut éclairer le plateau de mes chandeliers brachiaux… n’importe quoi…